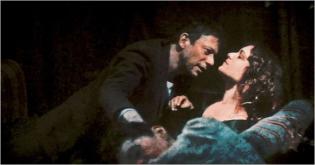Une sorte d’invocation cinématographique en somme (chaque journée de tournage débutait par une véritable séance de spiritisme) de tous les morceaux et bribes perdus de l’histoire du cinéma, rassemblés ici en un long métrage avant de faire l’objet d’une collection sur un site dédié (www.lachambreinterdite.fr), qui rassemble divers extraits formant un tout aléatoire. Inutile d’essayer de définir précisément ce qu’est ce film qui sort aujourd’hui en salles, puisqu’on y trouve pêle-mêle un sous-marin qui commence à se faire rare en oxygène, et où la seule solution de survie consiste en l’ingurgitation de pancakes détenteurs de bulles d’air ; un bûcheron échappé d’un gang de sauvageons et qui cherche à retrouver sa fiancée Margot, restée à leur merci ; un vieillard malaisant qui donne un cours sur comment faire couler un bain ; ou encore un homme qui, ayant oublié d’acheter un cadeau pour l’anniversaire de sa femme, ne voit d’autre échappatoire que de tuer un maître d’hôtel. Le tout entrecoupé de cartons donnant des notions quant au déroulement du semblant d’intrigue qui évoque bien sûr les temps anciens du muet, alors que La Chambre interdite a pourtant été tourné intégralement en numérique.

C’est, d’ailleurs, la performance technique qui impressionne le plus. Si Winnipeg mon amour (2009), Des trous dans la tête (2007) ou The Saddest Music In The World (2003) émerveillaient déjà par leurs prouesses visuelles, jamais autant qu’ici la force des images de Guy Maddin n’aura atteint ce point idéal d’onirisme et de pouvoir hypnotisant. Maddin et Galen Johnson, directeur artistique du film, semblent ne rien se refuser, expérimentant à la manière de chimistes : de fait, La Chambre interdite travaille le numérique comme il le ferait la pellicule plongée dans un bain de produits chimiques, et est profus en morcèlements, craquelures, griffures et boursouflures, comme un assemblage biscornu des reliquats de ces films rêvés, perdus ou simplement jamais réalisés. Tout en teintes improbables, dont on serait bien en peine de retrouver les couleurs dans la gamme chromatique, La Chambre interdite est aussi bien apparitions fantômes que film très organique, extrêmement palpable ; aussi poussiéreux que terriblement instable – il arrive que l’image, sous l’effet d’une friction, semble s’enflammer sous nos yeux. La Chambre interdite est un film expérimental au sens le plus pur du terme, dans la mesure où il ne semble jamais être autre chose qu’une série de tentatives et expérimentations, narratives et visuelles. Il arrive que certains segments donnent une impression de trop-plein – il s’agit, très littéralement, d’un gavage d’images – et que le film happe jusqu’à la fascination qu’on lui porte. Mais l’atmosphère cotonneuse, les bulles picturales qu’il offre et dans lesquelles se mêlent souvenirs et rêves enneigés, sont si belles qu’il serait bien dommage de ne pas céder à cette invitation au voyage.