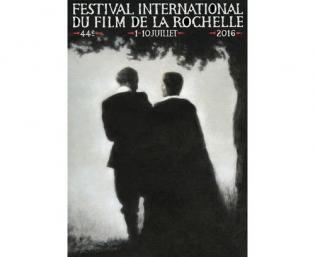L’événement majeur de cette édition restera la présentation de la filmographie intégrale du cinéaste danois Carl Theodor Dreyer. Si le moment fort du calendrier – La Passion de Jeanne d’Arc (1927) projeté dans une église, accompagné à l’orgue – nous aura échappé, le festival fut l’occasion de (re)découvrir une œuvre exigeante, que d’aucuns jugent austère, mais que beaucoup admirent. Au fil des séances, parsemées de quelques ciné-concerts, s’esquisse un univers peuplé d’icônes et de fantômes, de blancheur immatérielle et de ténèbres impénétrables, d’amour inconditionnel et de mort, entrelaçant visages et paysages en une même quête d’absolu. Un cinéma mystique, jamais prosélytique, rigoureux mais non dénué d’humour, à travers lequel tournoie tout ce qui fait vivre et ce qui fait mourir : "tout le cinéma de Dreyer, à partir de l’obsession du vivant et de ce qui le fige (la peinture, la sculpture, la mort), tourne autour de cette contradiction inexorable : le lent chemin vers un destin funeste et tragique (la mort) et cette utopie folle, par le pouvoir du cinéma, de redonner vie" (*). Entièrement recentré sur le fait religieux, Ordet (1955), probable point d’orgue d’une œuvre inégale mais traversée d’éclairs de génie, bouleverse justement par cette propension à redéfinir le cinéma comme espace de la croyance et du miracle, et à ramener la foi et son exigence d’absolu à la simplicité d’un visage d’enfant. Enfin, on ne soulignera jamais assez combien Dreyer était avant tout un cinéaste de la femme – ce qui n’est pas sans mettre en lumière l’un des aspects les plus saillants de son éclatante modernité.
La femme, une figure décidément au cœur du festival cette année, à travers la programmation consacrée aux femmes cinéastes turques, qui a rencontré un franc succès auprès des festivaliers. Depuis le récent engouement suscité par Mustang (Deniz Gamze Ergüven, 2015), l’heure est à la découverte et à l’exploration d’un territoire en pleine expansion, d’une cinématographie en train de se faire, où le simple fait d’être simultanément femme et artiste constitue d’emblée un acte politique. À travers ces films ancrés dans l’actualité la plus brûlante se rejoue cette conviction portée dans le cinéma comme medium de révolte, comme espace de la parole enfin retrouvée pour toutes les victimes de systèmes autoritaires. Si de multiples écueils ne sont pas sans se poser face à ce type de "films à discours" – au premier rang desquels une propension à la schématisation ou au surlignage – gageons que ceux que nous n’avons pas vus auront su trouver un recul, une ampleur et un équilibre entre la tendance plutôt didactique, solaire, mais trop scolaire, de Mustang, et celle, plus impressionniste, contemplative, mais trop raide, d’En attendant les nuages (Yesim Ustaoglu, 2004).

À La Rochelle, le cinéma français aura également été à l’honneur, que ce soit à travers la figure séminale du météore Jean Vigo (dont L’Atalante (1934), poème filmé d’une grâce et d’un humour ravageurs, a déplacé les foules), mais aussi avec Alain Guiraudie, cinéaste singulier et précieux révélé au grand public avec L’Inconnu du lac en 2012. Depuis quelques années, l’artiste albigeois fait souffler un vent de fraîcheur salutaire sur notre cinématographie nationale : désinhibés, jouisseurs, cocasses, tantôt sereins ou inquiets, ses films esquissent un univers à part, décalé, immédiatement reconnaissable, où les corps se livrent en toute liberté. Attaché intimement et artistiquement à un territoire, une région, Guiraudie s’est imposé, avec Bruno Dumont, comme l’un des derniers grands géographes du cinéma français – la fiction étant pensée avant tout en termes de lieux, de paysages habités et traversés. Si les premiers jalons de cette étrange filmographie ont pour eux un certain goût de l’aventure et un potentiel de surprise constamment renouvelé, ils restent plutôt inconséquents en regard de la pièce maîtresse que constitue L’Inconnu du lac – Guiraudie retravaillant son univers à l’aune d’une donnée nouvelle qui le transcende véritablement : l’épure.
Pour autant que l’on puisse en juger, la rétrospective de ce grand acteur italien que fut Alberto Sordi naviguait quant à elle entre valeurs sûres (L’Argent de la vieille (1972), brillante tragi-comédie de Luigi Comencini), ratés (Poussières d’étoiles (1973), interminable mascarade réalisée par Sordi lui-même) et coups de maître surgis de nulle part (Mafioso (1962), du trop méconnu Alberto Lattuada). Au fil d’une sélection dense et éclectique, les festivaliers auront également pu voir ou revoir quelques grands classiques, avec, en point d’orgue, le chef-d’œuvre d’Agnès Varda, Cléo de 5 à 7 (1967), suivi de quelques réjouissantes vocalises de la réalisatrice, accompagnées au piano par Michel Legrand sur la scène de la Grande Salle de La Coursive. De multiples avant-premières ont également émaillé la programmation, et notamment des films passés par Cannes (dont la Palme d’Or de Ken Loach, ou l’enthousiasmant Toni Erdmann (Maren Ade, 2016)). Nous aurions pu aussi nous attarder sur l’alléchante rétrospective consacrée au "documentaire animé", mais le temps nous a manqué pour faire le tour de la sélection décidément très imposante de ce festival à la fois populaire et cinéphile. Rendez-vous est donc pris pour l’année prochaine !
(*) Charles Tesson, brochure du festival, p. 10.