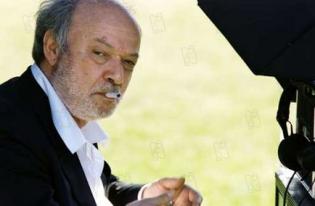L’artiste nous a quitté hier, lundi 12 janvier 2009, en milieu de journée, après avoir été hospitalisé dans la nuit de samedi à dimanche à l’hôpital de la Salpétrière à Paris, suite à un accident vasculaire cérébral. Le public, conquis par Tchao Pantin en 1983, lui doit sans toujours le savoir de nombreux moments de cinéma : Manon des sources ou Germinal, mais aussi Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, L’Ours, L’Amant, Amen, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre ou Bienvenue chez les Ch’tis…
Claude Berri, né Langmann le 1er juillet 1934 à Paris, était âgé de 74 ans.
À sa naissance dans une famille de confession juive, son destin est de devenir fourreur, comme son père. Il en fera tout autre chose, nous léguant aujourd’hui un héritage cinématographique impressionnant par son ampleur et sa diversité.
Des planches aux plateaux.
Sous son nom d’emprunt déjà, il fera ses premiers pas sur scène sous la direction de Jacques Pierre et Jacques Ruisseau dans les Mardi du Théâtre Caumartin, avant d’interpréter « le fils » dans le Tchin-Tchin de François Billedoux au Théâtre de Poche de Paris.
Sa passion pour la comédie devra tout naturellement le conduire au cinéma : il apparaîtra pour la première fois à l’écran en tant que figurant dans les films de Claude Autant-Lara, (Le Bon Dieu sans confession, 1953, et Le Blé en herbe, 1954), ou de Jean Renoir (French Cancan, 1955). Si Le Bon Dieu sans confession aura également été l’occasion d’un premier véritable rôle, c’est l’année 1958 qui verra son talent d’acteur reconnu, engagé qu’il sera par Pierre Chenal pour Les Jeux dangereux et Claude Loursais pour Les Cinq dernières minutes.
Suivront Michel Gast (J’irai cracher sur vos tombes, 1959), Claude Chabrol (Les Bonnes Femmes, 1960) et Henri-Georges Clouzot, qui lui offrira de jouer aux côtés de Brigitte Bardot et Jean Gabin (La Vérité, 1960), ainsi que Jean Aurel (La Bride sur le cou, 1961) ou Fred Zinnemann (Et vint le jour de la vengeance, 1964)…
C’est à cette époque-là qu’il passe derrière la caméra, l’un de ses premiers courts-métrages, Le Poulet, lui valant son premier Oscar en 1965. L’intime, voire l’autobiographique, est alors au cœur d’un cinéma qu’il écrit, réalise, interprète et produit le plus souvent, du Vieil homme et l’enfant (1966), avec Michel Simon, au Cinéma de Papa (1970), en passant par Mazel Tov (1968) et Le pistonné (1969).



De la réalisation à la production.
Le succès public viendra avec Tchao Pantin, en 1983, un film dans lequel il offre à Coluche un rôle à la mesure de sa dimension dramatique. Succès qui ne ne le quittera plus. Vient alors le temps des adaptations : Marcel Pagnol, avec Jean de Florette et Manon des Sources (1986), Marcel Aymé, avec Uranus (1990), ou Emile Zola, avec Germinal (1993), qui réunit une pléiade de célébrités : Gérard Depardieu, Laurent Terzieff, Jean Carmet, Miou-Miou, Anny Duperey… Son dernier film est sorti en 2007 : Ensemble, c’est tout, une histoire d’amour inattendue entre une artiste paumée et un cuisinier bourru, tiré du roman éponyme d’Anna Gavalda.
Outre ses propres œuvres, Claude Berri produira celles de beaucoup d’autres cinéastes : Philippe Garrel, Maurice Pialat, Serge Gainsbourg, Roman Polanski, Philippe de Broca, Bertrand Blier, Claude Sautet, Claude Miller…
Ainsi, le box-office français lui devra également de nombreux « blockbusters » : L’Ours et L’Amant, de Jean-Jacques Annaud, Gazon maudit, de Josiane Balasko, Didier et Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre, d’Alain Chabat, Astérix et Obélix contre César, de Claude Zidi, La Graine et le Mulet, d’Abdellatif Kechiche, ou encore Bienvenue chez les Ch’tis, de Dany Boon.



Son statut de figure incontournable du cinéma français lui aura valu la présidence de la Cinémathèque française, un poste qu’il occupera de septembre 2003 à juin 2007.
Enfin, si le cinéma était toute sa vie, Claude Berri entretenait aussi une passion avec l’art contemporain, le design et la photographie. Il venait d’ouvrir, en mars 2008, un espace au cœur du Marais, à Paris, pour y exposer sa collection personnelle commencée dans les années 1970.
Claude Berri a rejoint son fils, l’acteur Julien Rassam, dont il ne s’était pas remis du suicide, en 2002, ainsi que Guillaume Depardieu, l’ami à l’occasion de l’enterrement duquel il aura fait sa dernière apparition publique. Il lègue à son second fils, l’acteur et producteur Thomas Langmann, un patrimoine qui restera, du moins en partie, consacré au cinéma. Il laisse au public français un dernier film à découvrir, Trésor, une comédie avec Mathilde Seigner et Alain Chabat qu’il était en train de réaliser, assisté de François Dupeyron.