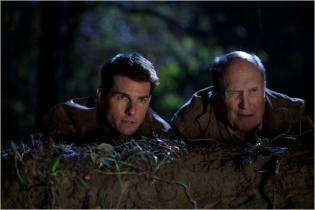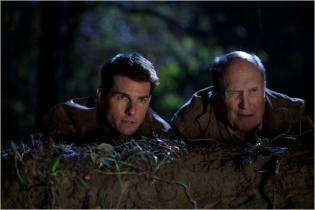Héros du romancier Lee Child, Jack Reacher, est un ancien marines aux états de services impressionnants et à la réputation de surhomme tant sur la plan physique (il peut mettre au tapis à mains nues une vingtaine d’hommes sans problème) que de par ses capacités intellectuelles qui font croire à certains moments que l’animal a la science infuse… Six personnes sont tuées par un sniper, lequel est arrêté peu après les faits. Ce coupable apparent va demander pour sa défense aux flics de retrouver Jack Reacher, qui a servi comme lui en Irak. Ce synopsis quoique des plus classiques n’est pas dénué d’intérêt. Il augure pourquoi pas d’un bon film policier, mélange de film d’action et de thriller. Or au bout de plus de deux heures il n’en est rien. On a déjà tout oublié. Peut-être est-ce sous le coup de la fulgurance de l’œuvre qui vient de nous percuter que nous avons perdu toute trace dans nos esprits de l’objet en question, que sans doute le film, un peu plus tard, va se décanter dans notre tête, nous léguer un parfum et nous émouvoir a posteriori ? Rien de tout cela malheureusement et il faut bien dire que de ce point de vue-là le film de Christopher McQuarrie (scénariste de The Usual Suspects en 1994) est inutile puisqu’il ne possède pas la vertu essentielle d’un film à savoir celle de graver dans nos esprits un peu de sa substance, l’empreinte d’une séquence, d’un plan – de pouvoir s’arrêter de temps en temps aussi.
Jack Reacher n’est donc qu’une longue succession de séquences déjà vues et revues selon un canevas qui ne laisse dès lors aucune place à la surprise et tue le suspense qu’il est censé engendrer. Hormis une mise en place de l’action intéressante, les bruits de la ville, un théâtre des opérations filmé avec de gros moyens comme toujours dans ce genre de superproduction, se succèdent courses-poursuites, fusillades et conciliabules entre Tom Cruise et son faire-valoir féminin (Rosamund Pike) avec qui il fait équipe. À mesure que l’action avance le film semble de plus en plus insipide et son héros désincarné. Tom Cruise, qui est co-producteur, se met en scène comme un deus ex machina utilisant, nous l’avons dit, tous les ressorts et les lieux communs des blockbusters. Cette mise en scène de lui-même pour sa propre gloire ne passe pas. C’est plutôt une overdose de Tom Cruise qui nous envahit. L’acteur ne semble pas s’être départi de son côté puceau à la Porsche de Risky Business (Paul Brickman, 1983), alors qu’il semble vouloir incarner avec force sa situation de cinquantenaire « bodybuildé », superstar interplanétaire à qui on ne la fait pas. Deux images de lui-même pour le moins contradictoires et qui nuisent à sa crédibilité. Que Cruise conduise une Ford Mustang à toute berzingue ou flingue à tout va pendant la traditionnelle bagarre finale, Jack Reacher reste ennuyeux. Il y a des fusillades sublimes au cinéma, mais n’est pas Sam Peckinpah qui veut. Grâce au réalisateur d’Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia (1974), nous garderons toujours dans nos mémoires le goût de la chevrotine et de la poussière du Mexique. De Jack Reacher, nous ne retiendrons rien ou presque.
Articles recommandés