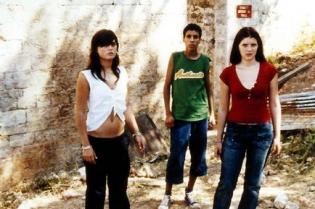Livia adore l´équitation. Moins par esprit de compétition que pour apaiser son ennui estival. Elle parcourt les allées de son village, scrute du haut de son cheval les petites gens, essuie les taquineries de son entourage, fuit la solitude de ces adolescents paumés et finit par tomber de son piédestal. Son prince charmant, Jean, la recueille, la dorlote, la soigne et la remet sur pied. Il est pompier, père de famille, amoureux de sa femme et beau comme un diable. Dans cette région provençale où le soleil plombe l´atmosphère, cet amour naissant ne peut que s´embraser. Réduite en poussière, la douceur de Livia disparaît définitivement. Son objectif : que Jean soit prisonnier de ses filets.
Claire Simon, documentariste de formation, ne fait plus dans la dentelle. Elle va droit au but, saisit parfaitement l´essence du cinéma. L´émotion doit être intacte. Plus d´artefact, plus de chichis lyriques, tout doit disparaître, ne retenir que la brutalité des corps, le vide des non-dits et surtout le réel des sentiments perdus. Coup de force ! Quelque chose nous heurte, nous malmène, nous déraisonne, cette vague étonnante nous ravit car nos sens s´en trouvent bousculés. Loin de toute suffocation, on respire la joie, on savoure ces images instantanées, on admire ces pauses narratives, on est loin d´un discours poussiéreux, on reste dans la définition du cinéma : plaire, toujours plaire !
Claire Simon entraîne son héroïne (et nous avec) vers une mort certaine. Une tragédie méridionale aux accents rosselliniens. Un film qui se donne les moyens de présenter un quotidien banal, des dialogues simples et des gestes courants. Ces instants de vie complètement ordinaires se transforment progressivement en une narration extraordinaire, chose rare dans le paysage cinématographique français. Lorsque Livia se promène sur son cheval dans ce village calme, c´est toute une théorie du cinéma qui se matérialise sous nos yeux. Cette idée que l´on peut capter le sublime par des circonstances documentées, par le croisement de regards amoureux, par ces souffrances intérieures et surtout par ces silences, cette pensée est tout simplement exact. Quoique l´on en pense, Claire Simon vise juste. Son film est porté par une forme de grâce qui retient l´attention, ne tombant jamais dans un schématisme lourdaud. La force du cinéaste est d´avoir concentré sa mise en scène sur cette idée sans pour autant l´intellectualiser. Aucune hésitation dans les faits amoureux de Livia, elle sait ce qu´elle veut, ce qui permet à Simon d´installer une folie quasi progressive vers une chute finale dévorante et impressionnante.
Il ne faut pas être rebuté par ces longues séquences contemplatives où se dessine l´inexactitude sentimentale de Livia. Celle-ci, adolescente de son état, ne peut se permettre de caresser la douceur logique d´une chronologie amoureuse. Rapport complexe car trop éloigné de l´académisme des romans à l´eau de rose. Ici, on est en face d´un amour qui n´existe que dans les rêveries démoniaques d´une adolescente complètement perturbée. Désillusion familiale (un noyau déconstruit avec une mère infidèle et un père irresponsable), déconvenue amicale (un entourage trop éloigné de ses envies) et bizarrerie sentimentale. Jean refuse l´affection de Livia mais ne peut s´empêcher de veiller sur ses travers, grand frère imaginaire qui compte sur ce malentendu pour ramener à la raison une vierge effarouchée.
Le cinéma est un art qui se ressent. Il y a quelque chose d´innée dans ce matériau fragile, sensoriel et subtil. Quelque chose qui oscillerait entre l´air du temps et le mouvement des choses surannées. Passé et présent, même combat, même entourloupe, même envie de faire du réel pour mieux apprivoiser la beauté éclair des sentiments. Ce procédé, Claire Simon l´applique depuis le début. Depuis sa première envolée cinématographique, depuis ses premiers émois cinéphiliques, depuis que son idéal prit de l´ampleur. Ca brûle, dernière tentative, est une oeuvre sauvage, une innocence totalement retrouvée, celle de l´adolescence fiévreuse, incomprise et mortelle. Un film qui finalement mérite des éloges ne serait-ce que pour une mise en scène excitante.