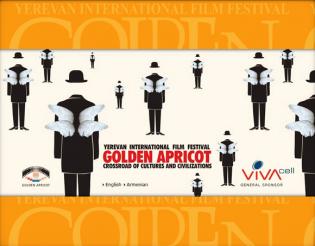Golden Apricot est le nom de ce festival, le bien nommé, dans ce paysage biblique avec le Mont Ararat en toile de fond, et ses vergers d’abricots qui seront bénis dans une église le jour de l’ouverture du festival. Un festival à la fois riche (plus de 160 films), de tout genre (fiction, documentaire, courts) et de tous pays. L’Arménie y est bien sûr représentée, mais aussi l’Iran, la Turquie, le Japon ainsi que la France grâce à UniFrance puisque le producteur Alain Terzian, franco-arménien, est même présent, avec Le Premier Cercle de Laurent Tuel et Le code a changé de Danièle Thompson. Il y a quand même mieux pour faire rayonner notre culture !
Avec une rétrospective des films de Rob Nilsson, de Jerzy Skolimowski qui ne sera pourtant pas présent mais dont on pourra voir le dernier film, Quatre nuits avec Anna, mais d’autres quasiment invisibles comme Walkover, de Kohei Oguri. Des hommages aussi à Arman Manaryan, Bagrat Hovhannisyan et Yubik Muradyan permettent de mieux connaître le cinéma arménien. « The Margaret Mead film & video festival » et des masterclass prestigieuses attirent tout particulièrement un public jeune et passionné. Il faut dire que l’Arménie est un pays étonnant, avec une diaspora étendue dans le monde entier et qui a su conserver intactes ses racines, sa culture et sa langue malgré génocide et dominations diverses.
Avec de nombreuses sections, donc de nombreux jurys auxquels participent, entre autres, Kohei Oguri, Arsinée Kahnjian (l’épouse d’Atom Egoyan, Arménien du Canada), Eric Bogosian, Nana Djordjadze, etc., c’est un festival international qui pourrait en rendre plus d’un jaloux, d’autant que les festivaliers sont particulièrement bien accueillis au cœur d’une ville attachante. Abricot d’or, soleil et magie figurent en bonne place dans ce pays où l’on parle encore avec passion de Federico Fellini et de Sergei Parajanov. D’ailleurs, les directeurs du festival, Harutyun Khachatryan dont on découvrira le film Border en avant-première (un film muet, le point de vue d’un bœuf sur le conflit arménien vs azeri dans les années qui ont suivi la domination soviétique), et Atom Egoyan ont décidé de clôturer ce magnifique festival par la projection du film de 1969 de Sergei Parajanov, Sayat Nova, qu’on voit hélas trop rarement et qui a fait école au niveau esthétique, notamment en influençant le cinéma mais surtout les clips.
Site officiel : www.gaiff.am/en