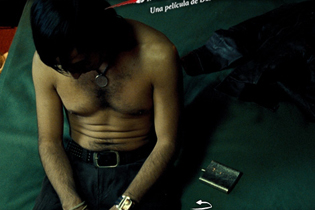Si le cinéma indépendant US a la côte, il est l’arbre qui cache une forêt luxuriante et éclipse souvent les productions corrosives, enlevées et énergiques des autres pays du continent. Outre les succès de Little Miss Sunshine ou de Juno, plusieurs festivals (Deauville, l’édition 2003 du festival international du film d’Arras en France, Sundance aux Etats-Unis) se sont faits les vitrines de ce cinéma en rupture avec les codes esthétiques et les circuits de financement made in USA.
Le festival du cinéma indépendant du continent américain va plus loin puisqu’il ne propose pas seulement des productions états-uniennes mais des films de l’ensemble du continent en portant son attention sur des problématiques ethniques, socioculturelles et d’immigration propres à des pays tels que le Chili, le Brésil, l’Argentine ou le Mexique. Le but avoué : porter ces sujets courageux jusqu’à la dernière étape de la distribution en privilégiant le jeune cinéma représentatif de l’esprit indi et underground du continent.
Sept jours durant, 16 films seront en compétition officielle dans deux catégories : fiction et documentaire. Désobéissance militaire au Chili (Desobéir), addiction énergétique et dépendance pétrolière (Crude Impact), puissance de la musique religieuse de Recôncavo (Nana Vasconcelos) et affliction de familles de disparus (Disparaître) constitueront les matières des documentaires en compétition. Les fictions brosseront des paysages aussi disparates qu’intéressants : du cauchemar américain d’une famille argentine (A traves de tus ojos) en passant par un conte moderne baigné de croyances populaires en Argentine (Gauchito Gil), d’une apnée dans le quotidien de Léna et Joe, jeunes parents en Amérique (Hamilton) en relations fraternelles et en rencontres imprévues (The brothers in Boston), sans oublier un joyau d’humour noir mexicain ou les tribulations d’une famille en pleins obsèques (Morirse en Domingo), le festival veut jouer le rôle de catapulte de productions décomplexées et intimistes.
L’autre objectif est d’inscrire l’évènement dans le long-terme en favorisant les rencontres entre les professionnels et les échanges d’idées en ouvrant les projections aux scolaires et étudiants d’écoles de cinéma. Dans cette optique et jusqu’au mois d’avril 2009, le FCIA présentera huit showcases de huit films inédits, six ateliers de « Team Coaching » d’improvisation et six tables rondes sur la thématique des échanges cinématographiques franco-latino-américain en partenariat avec le Studio Galande (édition d’une carte avec tarifs préférentiels).
De belles initiatives en projets courageux, ce festival veut pallier des circuits de distributions sinueux et le manque de visibilité de productions novatrices. Joseph Bédier avançait : « Le cinéma, c’est un œil ouvert sur le monde ». Encore faut-il garder aussi un œil sur le cinéma…ce que fait admirablement le FCIA.
Pour plus d’informations :
www.fcia.fr
www.myspace.com/fcica