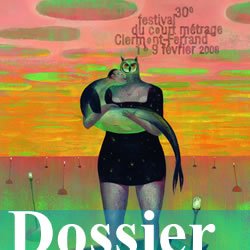Les W-C sont mon refuge depuis l’enfance. Alain Cavalier
Agnès Varda, Wim Wenders et le réalisateur du déroutant Lieux Saints, Alain Cavalier, sont quelques rares cinéastes à revenir spontanément à la forme du court-métrage, après des parcours étonnant. Lieux Saints, n’est, en effet, pas le premier coup d’essai du réalisateur. Assistant de Louis Malle à la fin des années 50, il passe vite au long-métrage dirigeant Romy Schneider et Jean-Louis Trintignant dans Le Combat dans l’île, et Alain Delon dans L’Insoumis. Des films politiques, censurés, qui restent des échecs commerciaux. Des œuvres moins controversées permettent ensuite au réalisateur de rencontrer le public, mais Cavalier, à ce moment, préfère se retirer et revenir quelques années plus tard. D’épure en épure, il parvient, dans les années 90, à tourner presque seul avec des moyens techniques réduits. Dans son dernier film, il décide de dresser un portrait surprenant des…toilettes.
Les toilettes d’un bar, d’une chambre d’hôtel, de particulier, qu’importe, Cavalier « a (toujours) puisé son inspiration dans les toilettes » se confie-t-il. Le metteur en scène sourit quand un journaliste compare les « toilettes de Cavalier » à la « madeleine de Proust ». Ce premier préfère alors évoquer la fonction animale du lieu et la réflexion de Blaise Pascal qui lui est venue dans les toilettes « Qui fait l’ange, fait la bête ». Un lieu aux apparences trompeuses donc, qu’Alain Cavalier tente de réhabiliter en l’érigeant au rang de rôle principal du film. Les Portraits*, uniques, subtils, drôles, d’une repasseuse, d’une illusionniste ou encore d’une fileuse, révélaient déjà la qualité d’écoute et de réflexion du cinéaste. De même les toilettes, comme les personnes, il les écoute et les entend et les filme avec tact et humour.
Adepte du plan-séquence, Cavalier parcourt ces Lieux Saints dans tous leurs détails : les chasses d’eau, la tuyauterie, les pastilles, les poubelles et bien sûr les cuvettes. Le reflet du cinéaste dans les miroirs, l’écriture et la voix de Cavalier, font oublier le dégoût qui peut envahir, sans réelles raisons, dès les premières minutes. Cette voix décrit, donne son avis et surtout se livre sur son intimité. Cavalier évoque en effet sa mère 102 ans ; sa mort marque un « changement » dans la vie du cinéaste. Pendant quelque temps, comme il l’explique dans une conférence de presse « les toilettes ne m’inspiraient plus, et ce, pour la première fois de ma vie ».
Enfin, même si le réalisateur reste moins loquace face au journaliste que dans ses Lieux Saints, il nous rassure en confiant que l’envie et l’inspiration est revenue. En attendant donc impatiemment un nouveau film ou Portrait de Cavalier.
* Portraits, réalisés entre 1987 et 1991 pour la télévision
NB : Alain Cavalier a été récompensé notamment pour :
1980 : Un étrange voyage, prix Louis Delluc
1986 : Thérèse, prix du Jury à Cannes, six Césars (1987), Meilleur film, Meilleur Réalisateur, meilleur espoir féminin, meilleur montage, meilleur photo, meilleur scénario ou adaptation.