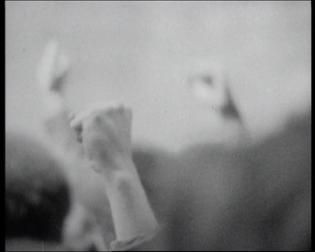Quand les petites histoires rejoignent la grande…


De cet idéal, les réalisateurs Mike Gray et Howard Alk ont puisé un foisonnement et une richesse que seule la caméra portée pour l’enquête sur le meurtre et l’enregistrement de ce qu’était cet animal politique, filmant au plus près des corps, pouvait matérialiser. Les gros plans, pris sur le vif, de Fred Hampton s’adressant à ses frères et sœurs, conjurant les pigs et autres motherfuckers, transcendaient les discours d’une vitalité et une puissance graphique que le cinéma documentaire seul, par cette immersion dans une bulle, pouvait retranscrire : l’énergie de cet homme insoumis à la peur était transposée à l’écran par de vifs et petits mouvements de caméra tous prompts à jouer sur la soudaineté et la spontanéité d’un discours galvanisant. Donner corps au discours par le corps et par l’image, déplacer le caractère communautaire de ces réunions en un universel changement de monde. Une réconciliation implicite entre les différentes ethnies. La façon de filmer cette utopie permet ainsi de concevoir le personnage Fred Hampton comme un mythe, et d’enregistrer de façon difforme et impure (par le prisme du corps des réalisateurs) une pensée en mouvement, une révolution en germe contre un racisme inavoué et cruel.
La plongée dans l’univers des Blacks Panthers, un monde en noir et blanc, comme pour neutraliser toutes distinctions de races ou de couleurs de peaux, asséché visuellement, tendant parfois vers une abstraction visuelle qui colle au plus près de la peau des personnes filmées, moralement en faillite, montre que la guerre qui sévissait au Viêt-Nam contamine le territoire américain. La justice y est caricaturée lors d’une séquence dans un tribunal fictif et inventé par les protagonistes du film, Fred Hampton en tête. Jouer c’est aussi créer, et les réalisateurs abandonnent temporairement leurs responsabilités. Les protagonistes dans cette séquence restent maîtres de leur personnage. Ainsi, les réalisateurs du film optent pour les deux tendances fondatrices et génériques du documentaire. A savoir celle de la reconstitution (la pratique de Robert Flaherty), dans laquelle la mise en perspective de la construction dramatique est dévoilée pour exprimer la vérité d’un conflit par une hétérogène construction filmique, et la technique du vif (pratique que l’on doit à Dziga Vertov), comme cela fut souvent le cas lors des discours derrière un pupitre ou sur une estrade, de la part du leader affranchi. La reconstitution du meurtre d’Hampton et le montage entre les allégations de la police, les paroles des Blacks Panthers, sont les écrins de cette double détente, de ce double motif de construction, puisque les deux pratiques du documentaire sont les avocates d’un enjeu fondamental, celui de la Vérité. Comme l’exprimait Marker, il faut utiliser les moyens de la vérité pour tenter de cerner la réalité.
Together
American Revolution 2 (1969) est, sous un certain aspect, ce que tentait de faire fructifier Hampton par des discours égalitaires entre les Américains défavorisés, qu’ils soient noirs ou blancs. En effet, le film montre la jonction dans la lutte contre l’injustice à Chicago entre les « Black Panthers » et les « Young Patriots ». Cette division devient néfaste, divisant les forces en présence. Il s’agissait aussi d’une manière de combler l’absence de leader charismatique qui tentait d’unir tous les Américains autour d’une même et noble cause, après les meurtres de Martin Luther King et de Bobby Kennedy.
Ces personnalités n’hésitaient pas à se mouiller contre les inégalités et le harcèlement que subissait le peuple par les forces de l’ordre au service d’une administration étouffante et aliénante. D’ailleurs, l’un des chevaux de bataille du film réside dans la dénonciation du harcèlement des policiers. Noirs, blancs, homos ou « rouges » (du fait de la paranoïa communiste de l’époque), les civils subissent des actes de violence et des préjudices moraux que le gouvernement ne cesse de proliférer pour écraser toute remise en question d’une norme sociétale. American Revolution 2 donne du pouvoir à cette mission d’auto-défense contre l’injustice. Le film en lui-même parvient à enregistrer concrètement la toute puissance de discours souvent intelligents et parfois décalés, la galerie de portraits se trouvant gorgée de différences, de dissemblances et de personnages quelquefois pittoresques. C’est lors de discours ou d’échanges parfois saugrenus que le pouvoir de la caméra fait d’un homme un personnage jouant devant la caméra, travaillé qu’il est de l’intérieur par l’intervention d’un média sur son existence. Le parfait exemple de ce genre de digression demeure l’échange contradictoire entre brothers devant un billard. L’un des deux hommes prend la parole, raconte son expérience injuste face aux forces de l’ordre, puis son interlocuteur lui demande si lui-même n’a pas plus jeune frappé sans raison. Sans réponse cohérente, sa pensée se délite derrière la gêne et l’altercation naissante avec un troisième homme. Cet échange démonte, démythifie le combat mené par des hommes à la fois imparfaits et fragiles. L’orateur recrée et invente un monde à sa guise, qui lui colle à la peau, mais la réalité le rattrape. C’est finalement la personne embarrassée qui va interrompre la fuite de sa crédibilité, en rappeler au réalisateur qu’il faut couper. Ce dernier s’exécute en annihilant la frontière qui peut exister entre le champ et le hors-champ du film. Il est nécessaire de préserver ce qui doit l’être : le moindre soupçon pesant sur les protagonistes de la seconde Révolution américaine, quitte à offrir une image trop parfaite du combat pour la liberté et l’égalité.


Le cameraman est lui aussi personnage et témoin de ce flot souterrain et résistant dans l’Amérique de la misère humaine. C’est aussi une manière métaphorique de briser la déliaison qui existe entre la norme communautaire de la société américaine. Le porte-parole de ce renouveau porte un nom : Robert E. Lee, organisateur de terrain des Blacks Panthers se rendant à une assemblée des Blancs du Sud afin d’insister sur les termes de discipline et d’organisation. Ce projet de société prend peu à peu corps avec les discours formateurs de Robert E. Lee, fondés sur la discipline, et les discours plus médiatiques et plus euphorisants, devant une audience d’emblée conquise, de Fred Hampton, construit sur la notion d’éducation. C’est ainsi que la paupérisation touchant les plus démunis s’accompagne d’un enrichissement intellectuel, ou du moins d’un progrès dans la recherche de la compréhension du monde. De cette pluralité, les Black Panthers voulaient faire un atout et s’arc-bouter sur un discours politique et anthropologique fondé sur la différence et l’acceptation de celle-ci. En vain… Quand la différence fait peur, elle meurt.
Source illustration :
Coffret ARTE DVD L’autre Amérique : The Murder of Fred Hampton et American Revolution 2