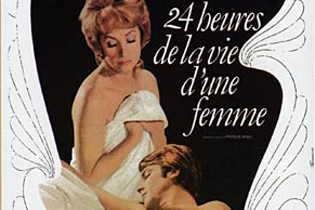Sortie le 23 Avril 2008, Opening, aucun bonus.
La sortie en DVD de 24h Heures dans la vie d’une femme permet de mettre en lumière un cinéaste méconnu et de découvrir -ou redécouvrir- un film en marge du contexte cinématographique de l’époque.
Sélectionné à Cannes en 1968*, ce film de Dominique Delouche fut retiré de la compétition à la suite d’un mouvement de solidarité sociale de certains cinéastes aux étudiants et aux ouvriers, rondement mené par Jean-Luc Godard et François Truffaut, entre autres. Si les années 60 sont marquées par la « Nouvelle Vague », 24 heures de la vie d’une femme semble en décalage avec ce mouvement empreint de révolution esthétique.
Alors que La Chinoise, Week-end, ou Baisers Volés illuminaient les écrans et que de nouveaux visages apparaissaient, Dominique Delouche, ancien assistant de Fellini, adapte le célèbre roman de Stephen Zweig, après avoir réalisé une dizaine de courts-métrages. Le cinéaste reconnaît volontiers « une espèce d’anachronisme entre le sujet et l’époque »** : une femme d’âge mûr en quête de sensations, alors que la Première Guerre Mondiale gronde, cela semble en effet bien loin des préoccupations de 68. Pourtant, dans une certaine mesure, c’est le portrait d’une femme libre, incarnée par Danielle Darrieux (qui n’avait pas moins de 35 ans de cinéma en 68), que peint Delouche : il la considérait comme son « stradivarius », gage de « haute qualité et de haute finesse », et qui offre en effet au film une de ses principales qualités. Une liberté résonnant avec certains des personnages de la Nouvelle Vague, même si celle-ci est plus jeune et spontanée.
Certaines séquences sont très inspirées, à l’instar de celle de l’orage au début du film ; les cadres, précis, jouissent d’un décor et de costumes particulièrement soignés, qui ne sont pas sans rappeler les fresques de Max Ophuls, pour qui Delouche ne cache pas son admiration. Pourtant, malgré quelques passages en grâce, le film souffre d’un manque de rythme et s’essouffle rapidement, ne laissant qu’un souvenir de longueur et de désuétude.
Après ce premier long-métrage, Dominique Delouche tourne une trentaine de films (télévision, cinéma long et court confondus), dont une grande partie est consacrée à la danse et à sa captation, travail pour lequel le cinéaste est éminemment reconnu.
*Notons que le festival de Cannes 2008, 40 ans après l’édition de 1968, projette, dans la sélection Cannes Classics, quelques-uns des films qui n’avaient pas pu être vus alors : Peppermint Frappe, de Carlos Saura ; 24h heures de la vie d’une femme de Dominique Delouche ; The Long Day’s Dying de Peter Collinson ; Je t’aime, je t’aime de Alain Resnais ; Anna Karenine d’Alexandre Zarkhi…
** Interview donné dans 20minutes.fr, le 22 mars 2007
Articles recommandés